
LE LOUP
 LE LOUP |
Accueil | Sommaire |
Valise multi-support sur le thème du loup (en préparation)
| Ecole primaire de GIRMONT, CDDP, équipe de circonscription |

|
|||
|
|
R. Gouichoux | ||
| Les belles histoires | |||

|
M. Colmont | ||
|
Albums du père Castor
FLAMMARION |
|||
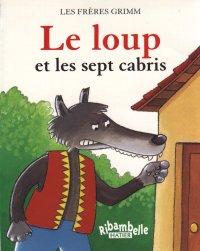
|
Les frères Grimm | ||
| Ribambelle
HATIER |
|||
|
|
LONDON, Jack | ||
| Gallimard jeunesse, 1994 | |||
| Cet album fait partie des valises | |||
| Un loup | A. Sanders | ||
| Ecole des loisirs | |||
| L'école des grands méchants loups | J. Alen | ||
| Bayard |
|
||
| La petite fille et les loups | A. Berton | ||
| Père Castor F1 | |||
| Loup gris | J. London | ||
| Père Castor F1 | |||
| Plouf | P. Corentin | ||
| Ecole des loisirs | |||
| Au loup | S. Fanelli | ||
| Gallimard jeunesse | |||
| Loup | O. Douzou | ||
| Editions du Rouergue | |||
| Jeannot-Loup et le cruel Albert | |||
| Belles histoires Bayard | |||
| Eloïse et les loups | |||
| Belles histoires Bayard | |||
| Le loup Loulou | |||
| Belles histoires Bayard | |||
|
Document Les loups |
N. Simon | ||
| Centurion jeunesse | |||

|
6 albums pour les 3/7 ans | Marlaguette
Monsieur le loup est amoureux Rebelle le loup Le loup sentimental Maxime Loupiot Le loup est revenu Les loupiots et l'agneau
|
|
| C.N.D.P. | |||
LE LOUP
par Olivia Colombel (Université Lille III, 1997)
Extrait du site université lille3
I. Le Loup dans l'Histoire
a) Une bête mauvaise et malfaisanteLes portraits de loups ressemblent à des caricatures tellement les traits dont ils sont affublés sont grossiers: nuisibles, inutiles, dangereux, cruels, etc. Entre faits et légendes, la peur a bâti un empire d’exagération où ils furent d’éternels accusés. On ne parle pas du loup de peur de voir sa peur prendre forme. Ainsi l’homme l’appelle la « Chose », la « Bête ».
Il existe toutes les chances pour que la fameuse histoire entre l’homme et le loup ait vu le jour au coeur des civilisations pastorales. A cette époque, si l’élevage permit en effet aux hommes de se procurer de la nourriture sans s’exposer aux dangers de la chasse, il facilita aussi la tâche des loups dont la convoitise fut excitée par des troupeaux alléchants tenus à portée de crocs: alors les bergers et les loups entrèrent en guerre...
Au Vième siècle au royaume des francs, de toutes les créatures vivant dans le pays, le loup est l’animal féroce le plus répandu et par conséquent le plus redouté. La tradition chrétienne ne peut donc ignorer son existence: elle le compte même au nombre des fléaux envoyés par Dieu pour punir les hommes, et qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans les textes bibliques. Désormais le loup n’est plus seulement « l’égorgeur » comme le nommaient les hébreux, mais il est devenu l’ennemi de Dieu, le symbole du Mal contre le Bien.
b) Le mangeur d’hommes
On peut dire que du IVième siècle avant Jésus Christ au XIXième siècle, les histoires où le loup fait de l’homme sa proie abondent. On va même jusqu’à dire que celui-ci aime la chair humaine. Au XIXième siècle, Gastor III de Foix énonce cette certitude et va jusqu’à ajouter que le loup préfère toutefois la chair des enfants qui est plus tendre.
L’Occident chrétien ne voulait pas du loup. Ils infestent les forêts, détruisent le gibier et, de leurs gîtes inaccessibles, attaquent les troupeaux, bergers, bûcherons et voyageurs. D’ailleurs, de l’an 930 au XVIième siècle, on bâtissait des abris pour les voyageurs égarés et surpris par la nuit.
Au XVIIième siècle, l’Ecosse décide de brûler ses forêts, repaires des loups, des rebelles et des bandits de tout ordre. En France, au XIXième siècle, les loups ont la réputation de dévorer de préférence les jeunes bergères dans la fleur de l’âge et les garçonnets. Il est vrai que tout au long de l’Histoire, dans le monde entier, les récits de faits ou les loups seraient des mangeurs ou des tueurs d’hommes se sont répandus. En Europe, les bergers ne craignent pas seulement les loups pour leurs troupeaux, mais aussi pour eux-mêmes. En effet dans la morale judéo-chrétienne, le loup est l’ennemi, symbole du diable qui, dévorant les corps, s’approprie les âmes. En attendant les découvertes de Pasteur au XIXième siècle, le loup terrorise les campagnes car il est celui dans lequel on reconnait les stigmates de la « fureur », c’est à dire de la rage. Solitaire, il parcourerait, selon les dires, d’une traite bois et champs, attaquant tous ceux qu’il rencontre, bêtes ou gens.
Tout ceci sans oublier, bien sûr, l’histoire de la « bête du Gévaudan » qui débuta au XVIIIième siècle au début de l’été 1767. Cette histoire prendra fin le 19 juin 1767. Entre temps les autorités recensèrent 99 victimes, sans compter les blessés. Beaucoup de loups furent eux-mêmes tués lors de battues organisées sur ordre du roi. A l’époque on pensait bien entendu, que l’auteur de ces massacres était un loup monstrueux. Beaucoup de témoignages de l’époque furent contradictoires et fantaisistes. De plus les descriptions insuffisantes, l’absence d’autopsie sur les victimes et les loups abattus, rendent difficile le travail de reconstitution des faits. Pourtant, à la lumière de l’analyse des blessures infligées, de l’état des restes des corps, des caractéristiques des victimes, d’une meilleure connaissance du comportement des loups, G.Ménatory et J-J. Barloy affirment que la bête du Gévaudant n’était pas un loup, ni des loups, même si ceux-ci touchèrent aux cadavres, même ci ceux-ci furent tués à sa place.
a) Le loup dans les textes scientifiques et éducatifs
L’Histoire Naturelle du loup qui parait en 1749 et les années suivantes, a donc été écrite dans le siècle qui connut sans doute le plus grand nombre de ravages occasionnés par les loups en France. Il semble donc difficile, même pour un savant, de garder du sang froid en cette matière et d’observer avec objectivité ce qu’il était convenu de considérer en nos contrées comme « le principal ennemi de l’homme ».
Au XIXième siècle si, aux dires des auteurs qui n’hésitent pas à juger des moeurs des animaux en les comparant à celles des hommes, les habitudes du loup seraient d’une barbarie révoltante. Non seulement il mange, parait-il, fort gloutonement la chair de son ennemi qu’il trouve sentir bon, mais il apprécierait même plus que toute les autres celle des femmes enceintes.
Buffon, naturaliste français du XVIIIième siècle auteur de l’Histoire Naturelle, écrit au sujet du loup: « Désagréable en tout, la mine basse, l’aspect sauvage, la voix effrayante, l’odeur insupportable, le naturel pervers, les moeurs féroces, il est odieux, nuisible de son vivant, inutile après sa mort ».
Ecrits de nos jours, ces textes provoqueraient un flot d’indignation et seraient aussitôt démentis. Est-ce à dire pour autant que nos ancêtres connaissaient très mal les loups, qu’ils n’avaient jamais eu l’occasion d’étudier leurs moeurs et leurs habitudes, et que seule l’ignorance était responsable de ces lignes? Il faut plutôt croire qu’ils prirent peu de soin à observer un animal si répandu que sa vie semblait dépourvue de tout mystère et de tout intérêt; d’autre part le besoin pressant qu’avaient les hommes de se débarrasser de cette espèce constituait sans doute un a-priori contre lequel il eut semblé d’une dangereuse inconscience de lutter. La condamnation des loups par Buffon sera d’un grand poids: jusqu’au début du XXième siècle elle sera vulgarisée par les dictionnaires et les encyclopédies qui citent par exemple dans sa totalité le texte du naturaliste pour définir le loup dans leurs colones. Cependant dès la fin du XVIIIième siècle, on trouve dans quelques études consacrées au loup une tentative d’explication de sa cruauté qui rompt avec les arguments chrétiens ou manichéens des siècles précédents.
b) Le loup et la littérature de fiction
1. Légendaire du loup
Craint, détesté et maudit dans la réalité quotidienne, le loup ne devait pas connaître de répit dans le monde de l’imaginaire. Il est en effet devenu un personnage central de légendes, contes ou fables. Aux côtés de son compère le renard, il tient également une place prépondérante dans les nombreux contes d’animaux qui appartiennent à la littérature orale populaire de nos campagnes. Des écrivains reconnus comme La Fontaine, Perrault et Daudet l’ont à des époques différentes rendu célèbre grâce à des ouvrages largement diffusés, notamment auprès des enfants.
Or toute cette littérature concernant le loup, qu’elle soit écrite ou orale, contribue à renforcer la mauvaise « image de marque » dont jouissait l’animal déjà assimilé à un fléau. Noirci de défauts dont certains sont loin d’être inhérents à sa nature, le loup est tantôt ridiculisé et bafoué, tantôt rendu coupable de cruautés plus monstrueuses encore que dans la réalité. C’est ainsi qu’il a reçu le coup de grâce, victime de récits et de légendes qui lui ont survécu, il incarne encore dans l’imaginaire collectif et ce malgré sa disparition de nos contrées, un animal féroce, dangereux, peu intelligent...pour tout dire inintéressant et inutile. Finalement, toute ces légendes qu’elles soient d’inspiration sacrée ou profane, appellent plusieurs remarques. Tout d’abord, le ou les loups y sont toujours d épeints comme de très grande taille. On remarque aussi que dans toute légende, le narrateur augmente facilement le nombre de loups parfois même dans des proportions considérables. Par ailleurs les performances physiques de l’animal, déjà remarquables dans la réalité, sont décuplées. De plus, au loup féroce, puissant, dont chaque apparition sème la terreur, les croyances populaires ont facilement attribué un caractère surnaturel et démoniaque.
2. Le loup dans les contes
Dans le folklore rural, les contes animaliers occupent une place importante; les hommes en effet se sont amusés à imaginer des aventures mettant aux prises animaux sauvages et domestiques. Dans cette société parallèle, on trouve comme dans la société humaine, des élus, des sages et des parias. Parmi ces derniers figure le loup auquel une majorité de contes est consacrée.
Le loup est un sans logis qui tente vainement de violer la sécurité des abris où sont parqués les animaux domestiques qui excitent ses convoitises. Toujours perdant et dupé, le loup est le malheureux héros d’un cycle d’aventures sans fin. Non seulement il ne parvient pas à croquer les victimes qu’il a choisies, mais de plus il en est qu’il ne cherche même pas à dévorer: c’est le cas du renard qui fait pourtant preuve d’une méchanceté souvent cruelle à son égard. En contre-partie, rares sont les cas où le loup trouve la mort à l’issue d’un conte: il est sous-entendu qu’il participera à de nouvelles aventures, une fois atténuées les cuisantes blessures qu’ils ne manquent jamais de recevoir lors des multiples corrections que ses adversaires lui infligent.
Ces contes forment donc une chaîne dans laquelle le loup, comme les autres animaux qui y participent, se voit doté d’un caractère stéréotypé, de défauts et d’attitudes bien connus de l’auditoire et des lecteurs, qui anticipent sur le déroulement du récit et en savoure à l’avance le dénouement, toujours défavorable à son ennemi séculaire. Il convient en fait d’attribuer au loups maints défauts qui sont la condition de ses échecs répétés dans ce monde créé par l’imagination: « en mettant à mal son ennemi par la parole, l’homme se rassure en même temps qu’il se venge d’une peur qu’il éprouve bel et bien dans la réalité. Pour mieux se délivrer de la hantise de son ennemi, il le tourne en dérision, l’accable de moqueries, imagine pour lui des supplices cruels. Par leur volonté de se venger, les hommes ont accablé leur adversaire de façon tout à fait fantaisiste, sans aucun lien avec la réalité » (G.Ragache).
C’est ainsi que le loup des contes est affublé de traits de caractère qui en font un animal ridicule, et de surcroît porteur de péchés humains: il incarne le mauvais sujet, l’individu en marge de la communauté. Dans les contes d’animaux, la peur instinctive du loup par l’homme est devenue manque de courage honteux, poltronie et lâcheté. Le loup dans les contes ne prend aucun risque car il attaque toujours les plus faibles. Il est vrai que le véritable loup attrape plus volontier les proies diminuées, comme des animaux blessés ou malades. Cependant tous les carnassiers agissent de même, ainsi l’équilibre fragile de la nature est respecté. Dans les contes, au contraire, le loup est accusé de lâcheté, et se doit de recevoir le châtiment mérité. Si l’on ajoute à celà que le loup couard cherche son salut dans la fuite au moindre bruit inattendu, on imagine aisément le nombre de situations ridicules dans lesquelles il se trouve dans les fins de récits.
En plus d’être poltron, le loup des contes est dépourvu d’intelligence. Aucun autre animal ne tombe aussi facilement dans les pièges aussi grossiers soient-ils. On connaît l’exemple de la marmite d’eau bouillante ou le puits, dans lesquels il se précipite (Le loup et les sept chevreaux), ou encore le trou dans un étang gelé où il laisse sa queue (La pêche d’Ysengrin). Le peuple tente de se rassurer en annulant la force physique de la bête par son manque d’intelligence. Cette bêtise est décuplée par les nombreux contes où le loup croit conclure avec le renard rusé, une alliance qui n’est en fait qu’un marché de dupe.
D’autre part, et contrairement à la réalité, le loup des contes est gourmand et glouton, ceci sans doute parce que la gourmandise est l’un des péchés capitaux de la morale chrétienne. Ainsi, comme le commande la morale chrétienne, le loup doit être châtié: dans Le Roman de Renart, il est alors victime d’indigestions, de souffrances atroces, de noyade par lourdeur d’estomac, etc. Le loup des contes va même plus loin dans le pêché car pour assouvir sa faim, il se moque effrontément des pratiques religieuses. En effet dans le conte sus cité, il va jusqu’à se travestir en moine (Comment Renard fit Ysengrin moine); ou encore, malgré l’interdit religieux, il avale une chèvre un vendredi Saint. Il blasphème, viole l’enceinte de l’église pour y poursuivre sa proie. Après tant de défauts et de péchés commis, qui pourrait avoir envie de prendre le loup en pitié? Le loup est damné dans l’imaginaire pour des fautes commises dans le monde réel, et semble relégué pour toujours dans la noirceur.
Au XIXièmè siècle, avec La petite chèvre de M.Seguin, A.Daudet fait du loup un animal féroce qui s’attaque à la jeunesse et à la pureté. Ce loup au coeur de pierre n’a aucune pitié pour la plus belle de toutes les chèvres. Si les chèvres se succèdent dans le petit enclos de M.Seguin au pied de la montagne, il va de soi que c’est le même loup qui les a dévorées. De plus, il est l’animal sauvage et libre qui condamne par sa seule présence les pauvres chèvres domestiques à rester au piquet. Enfin, il n’a aucune grandeur d’âme et aucun respect pour sa courageuse petite victime qui se défend héroïquement avec toute l’énergie du désespoir. Quel enfant n’a pas alors souhaité la mort de ce loup?
Le grand méchant loup avait déjà frappé dans la version écrite du Petit chaperon rouge publié en 1697 et attribué à C.Perrault. Ce conte tire probablement son origine de récits appartenant au folklore de nombreuses régions de France. Ces histoires avaient alors pour fonction de mettre les enfants en garde contre les loups qui ressemblent à certaines races de chiens. Ce conte à lui aussi entaché sérieusement la réputation du loup; même si à l’origine, l’auteur de ce conte ait mis en garde, par la moralité finale, les jeunes filles contre d’autres sortes de loups qui « suivent les jeunes demoiselles ». Cependant, aujourd’hui les enfants qui composent la majorité des lecteurs de C.Perrault, comprennent le texte au premier degré. Ce conte de Perrault souffrait d’un handicap certain, l’empéchant d’atteindre le succès: le tragique de son dénouement. En effet les enfants aiment être rassurés après avoir essuyé une grosse peur. C’est pourquoi cet obstacle fut surmonté deux siècles plus tard grâce aux frères Grimm qui modifièrent le dénouement du conte. A présent un chasseur (ou un bûcheron) survient miraculeusement et ouvre le ventre du loup d’où sortent ses victimes qui, chance, avaient été avalées toutes crues. Cette version est aujourd’hui publiée par les éditeurs pour enfants.
Ce méfait commis par le loup vient s’ajouter aux autres et, il faudra désormais beaucoup de courage aux enfants pour respecter un animal ayant pour vocation de les avaler. C’est pourquoi, à l’école comme à la maison, les adultes éduquent les enfants dans le droit chemin de l’obéissance en invoquant la menace du loup. G.Ragache souligne le fait que de 1880 à 1914, la diffusion de ces textes a répondu à une double volonté: convaincre le plus grand nombre possible de citoyens qu’il est primordial d’anéantir l’espèce des loups, porteurs de rage, contre laquelle était alors menée une vigoureuse campagne médicale; et enfin, enseigner aux enfants qu’ils doivent faire confiance et obéir aux adultes sous peine de voir surgir le grand méchant loup. C’est de cettte façon que le loup a rejoint les croquemitaine, fée carabosse et autres pères fouettards qui guettent les enfants « pas sages ».
Le loup représente les aventuriers, les sans-logis, ainsi se méfier de lui c’est se méfier des rôdeurs, des hors-la-loi, des marginaux. Cette fonction sociale et éducative du loup s’est donc perpétuée en France malgré la disparition progressive de l’espèce, car avec l’école a survécu son image maudite et peu nombreux sont ceux, qui malgré les campagnes écologistes, regrettent l’extermination dont il fut la victime.
a) Le loup dans les textes scientifiques et législatifs
Un premier regard objectif est porté sur le loup en 1758, au cours du siècle des lumières, où Linné donna pour la première fois une dénomination scientifique au loup. Désormais il existe des critères scientifiques, tels que les mesures crâniennes très précises, des différences de taille, de poids et de couleur, sur lesquelles seront reconnues les 37 sous-espèces qui composent l’unique espèce de loup.
On sait que les auteurs chrétiens de bestiaires expliquèrent les différences morales et physiques entre chiens et loups, en disant que le chien est l’oeuvre de Dieu et que le loup est né de la volonté du Diable. Cependant, plus tard, les naturalistes y virent la preuve de la filiation qui les relierait: le loup est dès à présent envisagé comme l’ancêtre sauvage du chien domestique. Les scientifiques vont finalement se pencher davantage sur les moeurs du canis lupus pour en déduire des données objectives. Les résultats de ces observations scientifiques sont connus par les initiés mais beaucoup en ignorent encore le contenu. Le loup est un animal qui vit en société, souvent fidèle à une seule femelle. Ses attentions sont délicates pour les louveteaux même s’ils ne sont pas les siens. Par ailleurs en cas de décès des parents, les louveteaux sont toujours adoptés par un autre couple. La place essentielle qu’il occupe dans la chaîne alimentaire est reconnue. Lorsqu’il chasse, toujours dans l’unique but de se nourrir, le loup attaque la bête la plus faible, vieille ou malade.
A les côtoyer, les scientifiques s’étonnent de la prudence des loups et de sa crainte visible de l’homme. Il serait trop facile d’avancer qu’ils ont changé depuis l’époque du petit chaperon rouge, ou que la chasse qu’ils subirent leur a inculqué la peur de l’homme. Plus sûrement, c’est en fait le regard que nous portons sur les loups qui commence à changer.
Au regard de la loi et des textes législatifs, le 19 septembre 1979, la Convention de Berne déclare l’espèce des loups protégée et décide d’indemniser les dégâts éventuels commis par cette espèce sur les troupeaux. Onze ans plus tard, en janvier 1990, la France adopte cette résolution. Elle hésita longtemps sous prétexte qu’elle ne comptait aucun loup sur son territoire. Cependant c’est elle qui mobilise l’armée dès qu’un loup, inconscient des frontières, pose une patte sur son territoire. Ce fut le cas en 1954, en 1968, en 1971-1972 et en 1987. Ceci illustre tout le chemin qu’il reste à parcourir afin que le loup ne soit plus victime de notre peur collective.
b) Le loup dans la littérature contemporaine
De nos jours, dans les bibliothèques, on peut trouver un certain nombre de volumes concernant le loup. Ces derniers de présentations et de contenus fort divers, peuvent être regroupés en trois catégories. Tout d’abord, il y a les documentaires, puis les romans d’inspiration réaliste et enfin les oeuvres de fiction qui sont elles-mêmes partagées en deux groupes: les contes merveilleux et les contes animaliers. Selon les cas les loups y sont traités avec mépris ou avec égard.
En littérature, un grand pas en avant a été franchi en ce qui concerne le loup avec un auteur anglais Jack London, qui, au début du XXième siècle, consacre dans son oeuvre une grande place aux loups, seigneurs des forêts du Grand Nord canadien. Les romans de J.London sont de type réaliste. Dans ceux-ci, l’auteur montre que les loups obéissent à «la loi suprême » de la nature et il n’y a aucune rancoeurt, ni animosité envers eux. Ceci est particulièrement lisible dans son roman de 1903, Croc Blanc, où le jeune louveteau apprendra bien vite à suivre cette loi, car c’est au nom de celle-ci que les loups sont condamnés, comme d’autres prédateurs, à courir à la poursuite d’autres vies à dévorer afin de perpétuer la leur. D’autre part, pour J.London, le loup incarne aussi l’amour de la liberté, la haine de la servitude et de l’esclavage. En effet, il montre qu’en raison du sang de loup qui coule dans ses veines, Croc Blanc ne ressemblera plus à ses frères les chiens; cependant, en raison de son sang de chien, il finira par céder à l’affection d’un homme exceptionnel qui entreprendra de le réhabiliter. traduits en français dès le début du XXième siècle, les récits de J.London constituent encore aujourd’hui une des lectures préférées des enfants, qui y apprennent à mieux connaître et apprécier un animal qui, certes tue et mange de la chair, mais par nécessité, non par cruauté.
Dans la tradition des romans réalistes, on peut encore citer Farley Mowat avec son roman Mes amis les loups, dans lequel l’auteur qui s’est pris de passion pour cette espèce, tente de mieux les faire connaître et peut être aussi de les faire aimer. Le roman d’Elma Malterre, Le dernier loup d’Irlande, raconte l’acharnement des hommes à exterminer les loups et comment le dernier survivant de cette espèce a su aimer un petit homme. G.Ménatory nous cite encore d’autres auteurs défenseurs des loups tels que Kipling, C.R Dumas, J.O.Curwood, M.Batten et G.Owl.
D’autre part, l’intérêt grandissant des enfants pour les animaux explique qu’un grand nombre d’ouvrages sur la nature, comme les documentaires, soient publiés. Mais de nos jours il ne s’agit plus de livres purement descriptifs car l’accent y est mis sur l’étude des rapports entre l’homme et le monde animal, sur la nécessité de préserver un équilibre trop souvent rompu. Ces albums ont donc pour fonction de sensibiliser la jeunesse à l’aide d’exemples concrets, comme celui de la disparition des loups de vastes régions du monde. La tâche prioritaire demeure de convaincre les enfants que les animaux sauvages ne sont pas « méchants », et que l’on ne peut, ni ne doit, juger leurs attitudes et leurs moeurs selon une morale définie par et pour l’homme, comme on l’a souvent fait en littérature. Dans le cas des loups, il faut en plus vaincre une peur transmise depuis des générations, bien ancrée dans notre société. Ces ouvrages ayant pour but de familiariser l’enfant avec cet animal, sont très peu nombreux à être spécifiquement consacrés aux loups.
En 1921, un autre pas est franchi avec le récit merveilleux intitulé La fille aux loups qui s’apparente aux contes merveilleux traditionnels de Perrault ou des frères Grimm. L’histoire retrace le parcours d’Anémone, jeune fille pauvre, douce et vertueuse qui est maltraitée par une belle-mère acariâtre et jalouse. Elle découvre l’amour grâce à un prince charmant victime d’une malédiction. Pour sauver son bien-aimé, Anémone parcourt le monde. L’originalité est que la bonne fée traditionnelle lui accorde une aide précieuse en usant d’un moyen inattendu, car Anémone sera accompagnée de deux grands loups à l’âme chevaleresque, doués de pouvoirs extraordinaires. Le loup jusque là instrument du mal dans les contes merveilleux, change de camp pour se mettre au service d’une jeune fille. Est-ce pourtant le signe d’un ton nouveau? Pas vraiment, car à la même époque en 1928, M.Alamic utilise, dans un roman, le terme de «loup » pur désigner des êtres cruels, violents et barbares et ne sera pas la dernière à le faire.
On peut citer la démarche très originale suivie dans un album du Père Castor (Flammarion), ou M.Colmont y conte l’aventure surprenante d’une petite fille, Marlaguette, qui semble prête au début du récit à s’engager sur les traces du petit chaperon rouge en rencontrant un grand loup dans les bois. Mais, entre eux va naître une grande amitié réciproque. Ainsi le loup promet à son ami de ne plus jamais manger de viande, ce qui le conduit à la maladie et au dépérissement. Plus tard, Marlaguette le délivrera de sa promesse car elle aura appris que chacun obéit à des lois naturelles et suit des voies différentes. Sous l’apparence d’un conte, cette histoire pose une question cruciale: comment faire comprendre aux enfants l’apparente cruauté de l’animal?
De nombreux récits merveilleux écrits récemment tentent ainsi de réhabiliter le loup et de dénoncer la cruauté de l’homme qui surpasse toutes les autres. On peut citer par exemple Sur la piste du loup de D.Meynard, Clair de loup de T.Lenain, L’oeil du loup de D.Pennac. D’un autre côté, de nos jours, certains adultes écrivant pour la jeunesse suivent les dires de certains psychologues qui avancent que les enfants doivent avoir peur pour leur bon développement. Ainsi, ils se sont plus à développer et à entretenir la fascination mêlée de répulsion que selon eux tous les enfants doivent éprouver à l’encontre du loup. Une fois de plus, quelques auteurs font du loup un mythe plus qu’un animal réel. Ils en font un personnage répondant aux fantasmes humains. Le loup se trouve de nouveau au rang des croquemitaines et horribles monstres. Dans cet esprit, on trouve le petit album de T.Danblois intitulé Papa fait moi peur (Ed. Dupuis). On peut de même citer Le sorcier aux loups de P.Thiès, où le loup incarne à nouveau un animal sanguinaire et monstrueux. Le loup y est un instrument terrible entre les mains d’un homme qui sait les manipuler jusqu’à un certain point. Enfin, une petite pièce de théatre écrite par B.Castan, Les loups, nous rappelle tout le mépris et les préjugés que l’homme nourrissait (et nourrit sûrement encore) à l’égard du loup.
Heureusement, des auteurs ont écrit de nouveaux contes pour enfants où le loup est sympathique et vu de façon anthropomorphique. On remarque par exemple Quand on parle du loup... d’A.Surget, où est contée l’histoire de Fi-loup, un jeune louveteau vivant au sein de sa famille. Celle-ci, dans ses rapports, est assimilée à une famille humaine. On trouve aussi des contes pleins de verve et de fantaisie où le loup est prétexte à divertissement. Sous cet angle, il y a Les contes du chat perché (1938) où M.Aymé confronte Delphine et Marinette à un loup qui s’ennuie et veut jouer avec elles. L’auteur emprunte la fin du conte de Grimm, mais les deux enfants obtiennent la grâce du loup.
Quelques ouvrages récents destinés aux adolescents sont à mi-chemin entre les romans d’inspiration réalistes et les récits de pure fiction. G.Ragache se prononce au sujet de ces ouvrages dont il trouve le récit souvent gâché par la fiction s’introduisant dans le fil de l’histoire à des moments donnés. Selon lui, la fiction idéalise souvent le loup mais sans vraiment oeuvrer à sa réhabilitation. Le loup doit tenir sa place entre le chien domestique et la bête sanguinaire.
Les siècles passés portent à la fois les traces des méfaits commis par le loup, mais aussi celles des massacres qui lui ont été imputés. L’homme de son côté a transmis de génération en génération, des légendes, des fables où il a décrit toute sa peur, son dégoût, son mépris, mais aussi sa fascination pour cet animal. De nos jours, que reste-t-il de tout celà ?
Certainement une peur amoindrie que nous a légué l’histoire et ses légendes; mais aussi une fascination grandissante chez l’homme maîtrisant mieux le sujet. Il reste aussi un peu de mépris mêlé de méconnaissance. Dans tous les cas, la littérature demeure très prolixe au sujet du loup dont les visages y sont changeants.
Ainsi on trouve une littérature de fiction, héritière des anciennes légendes, maintenant l’enfant dans la peur du loup. D’autre part, le loup peut être, dans certains contes, un prétexte de divertissement. Mais il y a surtout des romans, des récits où les auteurs foulent aux pieds les vieilles légendes et rendent au loup le respect qu’il mérite, certains allant même jusqu’à l’idéaliser.
Il faut encore citer les ouvrages de type documentaire, moins nombreux, mais dont l’honnorable but est de faire connaître le loup aux enfants, en lui rendant la place qu’il n’aurait jamais dû perdre, ni meilleur, ni plus mauvais qu’en réalité.
Cependant, il y a fort à parier qu’en France le loup restera encore longtemps prisonnier de nos zoos et de nos préjugés.Bibliographie
BERNARD, Daniel. L’homme et le loup. Paris: Berger-Levrault, 1981. ISBN 2-7013-0456-3.
BONNET, Philippe. Le loup dans la littérature. Histoire d’une réhabilitation. Textes et documents pour laclasse.Septembre 1993, n°659.
CARBONE, Geneviève. La peur du loup. Gallimard, 19?. ISBN 2-07-053127-9.
CASTAN, Bruno. Les loups. Illustr. de Marie Nocher. Paris: Très Tôt Théâtre, 1993. ISBN 2-910360-00-8.
CRAIGHEAD GEORGE, Jean. Julie des loups. Paris: Editions G-P, 1972. ISBN 2-010-13978-X.
LENAIN, Thierry. Clair de loup. Paris: Rageot, 1994. ISBN 2-7002-2148-6.
LONDON, Jack. Croc-Blanc. Hachette, 1992. ISBN 2-01-015426-6.
LONDON, Jack. L’appel de la forêt. Illustr.de madame de Galard. Gallimard jeunesse, 1994. ISBN 2-07-058298-1.
MALTERRE, Elona. Le dernier loup d’Irlande. Illustr de Jean-Louis Henriot. Trad. de Marie-José Lamorlette. Paris: rouge et Or,
1992. ISBN 2-261-03691-4.MENATORY, Gérard. La vie des loups. Stock, 1971.
MEYNARD, Daniel. Sur la piste du loup. Illustr. de Rémi Saillard. Paris: Nathan, 1995. ISBN 2-09-282153-9.
MOWAT, Farley. Mes amis les loups. Flammarion, 1984. ISBN 2-08-161794-3.
PENNAC, Daniel. L’oeil du loup. Illustr. de Jacques Ferrandez. Paris: Nathan, 1994. ISBN 2-09-282104-0.
RAGACHE, Gilles et Claude-Catherine. Les loups en France. Légendes et réalité. Aubier-Montaigne, 1981. ISBN 2-7007-0264-6.
STINE, R-L. Le loup-garou des marécages. Trad de Jean-Baptiste Médina. Bayard, 1996. ISBN 2227729-120.
SURGET, Alain. Quand on parle du loup.... Illustr. de Thierry Christmann. Paris: Rageot, 1994. ISBN 2-7002-0465-4.
THIES, Paul. Le sorcier aux loups. Paris: rageot, 1992. ISBN 2-7002-1144-8.